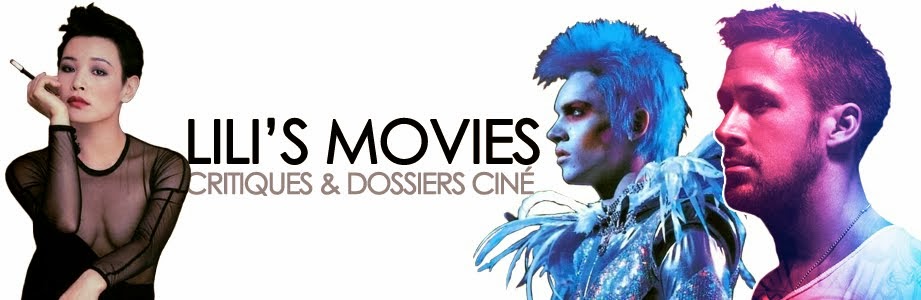Titres : L'Instinct de Mort ; L'Ennemi Public numéro 1
Réalisateur : Jean-François Richet
Avec : Vincent Cassel, Cécile de France, Gérard Depardieu, Ludivine Sagnier...
Date de sortie : 2008
Pays : France
Note : ♥♥♥♥
L'histoire de Jacques Mesrine (à prononcer "Mérine"
si vous ne voulez pas l'énerver, apparemment), on la connaît : celle
d'un homme qui, engagé dans les affaires criminelles depuis l'âge de 18
ans, est devenu l'Ennemi Public numéro 1, a braqué un nombre
incalculable de banques et s'est évadé de prison à plusieurs reprises,
avant d'être finalement assassiné par la police, le 2 novembre 1979. Il
avait 43 ans.
Jean-François Richet, qui n'avait alors à
son actif que deux films mineurs et inconnus, a décidé de raconter la
vie de Mesrine en non pas un, mais deux films, de presque 2h30 chacun.
Il s'appuie sur les deux autobiographies que Mesrine avait écrites lors
d'un de ses (nombreux) séjours en prison, intitulés L'Instinct de Mort et Coupable d'être Innocent,
et donne le rôle principal à Vincent Cassel, physiquement peu
ressemblant mais qui, comme d'habitude, parvient admirablement à devenir
son personnage.
Richet commence son film en nous disant
qu'aucune œuvre de fiction ne peut prétendre reconstituer à l'exact la
vie d'un homme. Pourtant, on a l'impression que le biopic se révèle
extrêmement complet. Je ne connais quasiment pas la vie de Jacques
Mesrine, mais quoi qu'il en soit, le réalisateur s'interdit de porter un
jugement sur le personnage, le montrant tour à tour comme un anti-héros
drôle et sympathique, et comme un homme violent qui met de force son
revolver dans la bouche de sa femme. À nous de nous faire notre propre
opinion...
...Opinion qui, pour ma part, se résume
principalement à une bonne dose d'admiration. Bien sûr, Mesrine a commis
des actes répréhensibles et non excusables ; mais les films nous
montrent à quel point l'homme n'a peur de rien, a un grand sens de
l'honneur, aide toujours ses camarades et, au fond, n'est pas si méchant
que ça - et même franchement marrant dans la vie quotidienne, si l'on
en croit le film. Ce gangster avide de reconnaissance publique et qui
aurait aimé être vu comme un grand révolutionnaire suscite la même
fascination que ses prédécesseurs, bandits célèbres à la John Dillinger.
Du coup, quand la police le prend en traître et l'abat froidement, sans
sommation, on trouve ça franchement dégueulasse.
Côté mise en scène, le film parvient
admirablement à faire monter le suspense. Dès la toute première scène du
premier opus, on nous plonge dans une ambiance oppressante et tendue,
avec un montage en split screen (écran divisé en plusieurs
parties) montrant simultanément, sous différents angles, la sortie de
Mesrine et de sa copine Sylvie (Ludivine Sagnier) d'un immeuble, juste
avant la mort de Mesrine.
Côté suspense, on retiendra principalement la séquence de L'Instinct de Mort où
Mesrine, simplement armé d'une pince coupante, s'évade d'une prison
québécoise ; pendant la demi-heure que durent les préparatifs puis
l'évasion en elle-même, on est assis sur le bord de notre siège, osant à
peine respirer. La musique (magnifique partition de Marco Beltrami et
Marcus Trumpp) et le montage - tout en gros plans, regards angoissés et
caméra subjective - créent une tension d'une intensité rare. De même
pour la scène de fin du deuxième film, où même si l'on sait pertinemment
comment elle va se terminer (la mort de Mesrine, annoncée dès le tout
début du premier épisode), on n'est pas moins happé par le suspense.
Le casting est sans faute : Cassel joue à
la perfection le rôle de Jacques Mesrine, adoptant le jargon
typiquement "voyou" et livrant une interprétation subtile qui reflète
bien la complexité du personnage - et parvient à rendre le criminel
attachant. Cécile de France, méconnaissable, incarne efficacement
Jeanne Schneider, l'une des copines de Mesrine ; Mathieu Amalric est
très bien choisi pour jouer le rôle de François Besse, un autre criminel
qui fait équipe avec Mesrine, et est vite exaspéré par son comportement
"grande gueule" et provoquant. Mention spéciale, enfin, à Gérard
Depardieu, comme toujours excellent, incarnant ici le premier "patron"
du jeune Mesrine tout juste revenu d'Algérie, Guido.
Les deux films se complètent tout en étant assez différents : le premier, plus film d'action, plus blockbuster,
se concentre sur les jeunes années de Mesrine, entre filles, évasions
spectaculaires et fuite incessante ; le second, plus intimiste,
développe le personnage de Mesrine et en révèle les multiples facettes,
s'attachant davantage à l'humain qu'au héros, et dévoilant les
motivations moins connues de l'homme.
Une biographie complète et
passionnante à voir absolument, tant pour la vie mouvementée de Jacques
Mesrine que pour la mise en scène et les acteurs, grandioses.